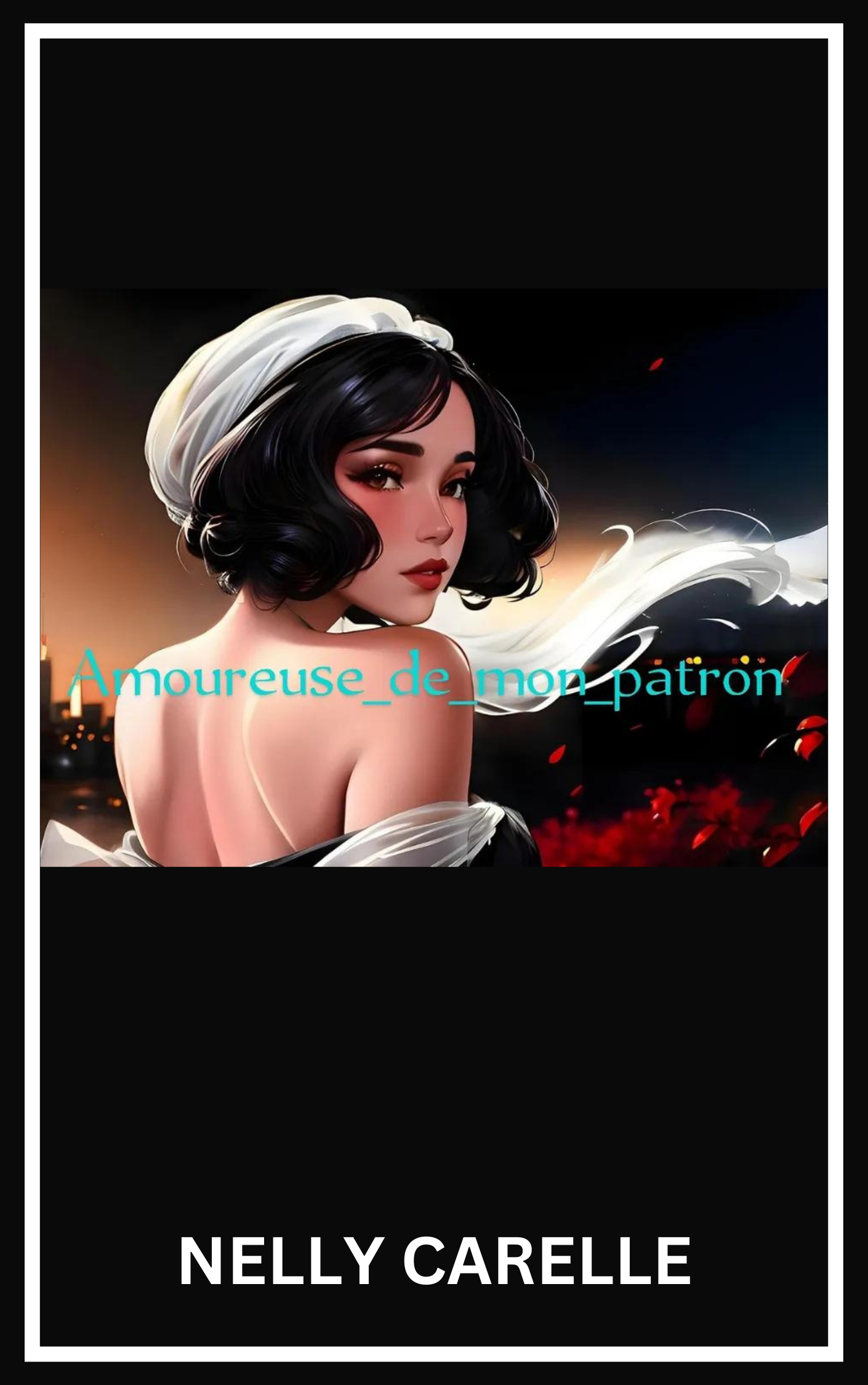La vie compliquée de Tchana-Robert
By Nelly Carelle
Chapitre 1
*La rencontre*
— Hey petite, viens par ici avec ton plateau de bananes.
— D’accord, Monsieur.
Je m’approchai tout timidement de cet homme qui avait garé une belle voiture sur le trottoir. Je le vis descendre et s’adosser à sa voiture bleue.
J’arrivai à son niveau et me tins juste en face de lui. Malgré le soleil qui s’était déjà couché, le lampadaire me permettait de distinguer les traits du visage de mon client.
Sur mon plateau, il me restait quelques bananes que je devais à tout prix liquider avant de rentrer chez moi,
sinon ma mère ne serait pas contente, et je serais une fois de plus privée de nourriture…
— À combien les vends-tu ?
— Chaque tas coûte deux cents francs CFA, Monsieur. Quel tas voulez-vous ? Il me regarda un moment puis rétorqua :
— Que fais-tu à cette heure dans la rue ?
Les enfants de ton âge sont à la maison, au chaud, en train de réviser leurs leçons.
— Je ne peux pas rentrer chez moi tant que je n’ai pas fini de vendre toutes mes bananes, dis-je d’un regard fuyant.
— Je ne comprendrai jamais ces parents qui livrent leur progéniture à la rue, dit-il tout bas avant d’ajouter à nouveau :
Si tu ne finis pas de les vendre, que t’arriverait-il ?
— Il vaut mieux que je n’y pense pas, répondis-je, la peur au ventre.
— Avec qui vis-tu ?
—Avec ma mère, Monsieur. Alors, vous achetez mes bananes ? dis-je, exaspérée par toutes ses questions.
— Je voudrais t’acheter tout le plateau.
— Vous êtes sérieux, Monsieur ? m’exclamai-je, heureuse.
— Oui, ça fera combien ?
— Deux mille francs CFA pour les cinq tas.
— D’accord. Emballe-les. Je m’empressai de le faire et mis le tout dans un gros sac en plastique jaune. Pour une fois,
je ne passerai pas à tabac ce soir. Il fouilla dans sa poche, en sortit un billet violet et me le tendit.
— Tiens, ma petite. Je restai silencieuse et embarrassée…
— Qu’est-ce qu’il y a, ma petite ?
— Monsieur, je n’ai pas de monnaie, n’auriez-vous pas un billet de deux mille francs CFA, s’il vous plaît ?
— Haha ! Il se mit à sourire.
— Qu’est-ce qu’il y a de drôle ?
— Rien du tout. Garde la monnaie, le reste est pour toi. Tu es polie et gentille.
— Désolée, je ne peux pas, ma maman m’a dit de ne pas accepter d’argent des inconnus.
— Ça me fait rire, mais elle te laisse vendre dans la rue jusqu’à des heures tardives. Ne sait-elle pas que tu es exposée à toutes sortes de dangers ?
— Mais…
— Ne t’inquiète pas, je ne suis pas une mauvaise personne. Sois sans crainte. Tu as l’âge de ma petite sœur. Comment pourrais-je te faire du mal ?
me dit-il d’un ton doux, affichant un air aimable. On voyait bien que c’était une bonne personne.
— Merci, Monsieur.
— Je t’en prie. Je me prénomme Grec, et toi ?
— Aya Tchana-Robert.
— Joli prénom. Pourquoi ton nom est-il composé ?
ACHETEZ LE LIVRE: Amoureuse de mon patron
— Tchana est celui de ma mère, une femme Bangangté, et Robert est le nom de mon père, un Français.
— Ok, je me pose mille questions à la fois.
— Je vais rentrer. Merci pour la recette, Monsieur.
— Hey, attends. Laisse-moi te déposer chez toi.
— Non merci, ça ne sera pas possible. Je ne voudrais pas m’attirer les foudres de ma mère.
— Je comprends. Laisse-moi au moins payer un taxi pour que tu rentres, ça, j’y tiens.
Il me saisit la main sans que je ne m’y attende. Nous traversâmes la route de l’autre côté.
— Où habites-tu ?
— New Bell…
— Ok ! Il arrêta un taxi et lui donna des directives.
— C’est un dépôt. Laissez-la à New Bell, elle vous indiquera sa maison. Combien je vous dois ?
— Trois mille francs CFA, Monsieur.
— Ok ! Il sortit un billet de cinq mille francs CFA et le tendit au chauffeur, qui lui rendit la monnaie.
— Soyez prudent sur la route et ramenez-la à bon port, s’il vous plaît. Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone ?
Je vous appellerai plus tard pour me rassurer.
— D’accord, Monsieur. Le chauffeur s’exécuta et lui remit son numéro de téléphone.
— Au revoir, Aya.
— Merci beaucoup, Monsieur Grec, que Dieu vous bénisse.
Le chauffeur démarra. C’est ainsi que cette belle âme mystérieuse venait de me sauver d’une bastonnade imminente. Je me demandais bien d’où il venait.
Pourquoi avait-il été aussi avenant avec moi ? Selon ma mère, je n’étais pas digne d’être aimée. J’étais une erreur de la nature. Pourquoi aider une erreur de la nature ?
Je demandai au chauffeur de me déposer un peu plus loin.
Je ne voulais surtout pas qu’il se gare devant la cité pour éviter que des rumeurs ne se répandent à mon sujet.
J’étais dans un quartier populaire où les nouvelles se propageaient comme une traînée de poudre.
Je remerciai le chauffeur et me mis à parcourir les quelques mètres qui me séparaient de ma maison.
Notre cité renfermait une diversité de personnes. Elle comptait trois chambres et deux studios. Le bailleur résidait juste en face, de l’autre côté de la route.
Dans l’un des studios vivaient deux frères Bamouns , Sahib et Hakim. Ils étaient tous deux commerçants et avaient une boutique de mercerie au marché.
Ils sortaient très tôt et rentraient très tard, on les voyait peu. Le dimanche était leur jour de repos.
Ils étaient très gentils avec moi et n’hésitaient pas à me ramener des douceurs de Mme Adja, la vendeuse du carrefour.
Elle faisait de succulents beignets, une spécialité des Bamouns. J’en raffolais.
Parfois, je restais longtemps devant la porte, attendant patiemment leur retour, tenant mon trophée dans leur main. Lorsqu’ils s’approchaient de notre porte, mes yeux brillaient à l’écoute de leur phrase fétiche :
— Des douceurs pour la belle Aya. Régale-toi, petite sœur. Bonne nuit.
Et moi, je ne manquais jamais de leur dire merci. Nous fûmes les premiers parmi nos voisins à emménager, ensuite Sahib et Hakim emménagèrent quelques mois plus tard.
J’avais cinq ans. Plus de neuf ans que je les connaissais, je les considérais comme mes grands-frères, tant de fois ils s’étaient indignés du comportement de ma mère.
Tant de fois, ils m’avaient sauvé de ses griffes. Vous comprendrez plus tard…
Dans l’autre studio, collé à celui des frères Bamouns, vivait une famille de trois,
originaire du Centre. M. et Mme Owona étaient un jeune couple trentenaire qui avait une fille âgée de douze ans, prénommée Célia.
C’était mon amie, nous fréquentions le même établissement secondaire. Célia était de teint ébène et élancée, je la dépassais de quelques mètres en taille.
Je l'enviais parfois ,
elle grandissait dans un cocon familial dont j’avais toujours rêvé.
Elle était aimée et choyée par ses parents, tout le contraire de moi. Les seuls moments de répit où j’avais la paix avec ma mère étaient lorsque je dormais.
Même dans mes rêves, je la voyais me rabâcher à quel point j’étais inutile et qu’elle maudissait le jour de ma naissance.
Des paroles blessantes qui me causaient tant de peine. Elles étaient bien enfouies en moi et chaque jour, je perdais un peu plus d’estime pour moi.
La chambre que j’occupais avec ma mère était au milieu de celles de deux jeunes femmes : Annie à notre gauche, et Sally à droite.
Toutes deux étaient étudiantes dans une université privée de la place. Je les voyais peu, mais nous avions une belle complicité.
Sally était celle que j’admirais beaucoup, elle était d’une beauté à couper le souffle, et d’une douceur sans pareille.
Tous les gars du quartier n’avaient d’yeux que pour elle, mais elle n’avait guère de temps pour eux, sa priorité était ses études.
C’était une fille très coquette, tout comme Annie. Parfois, nous nous retrouvions dans la chambre de l’une d’elles et nous papotions.
Elles me donnaient beaucoup de conseils. L’un que j’ai toujours gardé de Sally était de me rattacher à l’école,
car elle me sauverait et ferait de moi une femme d’impact. Annie n’était pas aussi sérieuse que Sally. Parfois, des hommes défilaient chez elle.
Je pouvais la voir avec l’un ce mois-ci, et le mois d’après, on la revoyait avec un autre.
Je ne la jugeais pas, car ce qu’Annie faisait n’était pas différent de ma mère :
au moins, elle le faisait pour payer ses études, alors que ma mère le faisait pour payer sa drogue…
Ah, la vie ! Parfois, je me demandais bien ce que je lui avais fait pour qu’elle soit aussi dure avec moi. J’avais l’impression de n’avoir aucun repère.
Entre un père absent que je n’avais jamais connu, et une mère alcoolique qui se prostituait et, de surcroît, me faisait la misère, ma vie était bien compliquée. Fort heureusement, j’excellais à l’école.
Ma mère se demandait d’où me venait cette intelligence, car selon elle, mon père était trop con pour que je lui hérite cela…
Bref, je vous épargne pour le moment ses critiques. J’arrivais devant la porte de notre chambre, et je la trouvais fermée de l’intérieur.
La pièce était éclairée, les bruits de jouissance me parvenaient de l’intérieur.
Je compris qu’un énième client consommait sa paie à l’intérieur. Je patientais dehors, tout près de la porte, avec ces cris assourdissants qui me transperçaient comme des poignards.
J’avais si mal de l’intérieur. Pourquoi ma mère me faisait-elle subir tout cela ?
Elle salissait notre couette en ayant des relations sexuelles avec des hommes aux appétits insatiables. Elle me dégoûtait…
Après une dizaine de minutes de torture sonore, la porte s’ouvrit et les deux sortirent. Un homme très mûr, avoisinant la cinquantaine, sortit.
Il referma sa braguette et essaya d’arranger sa chemise en désordre.
C’était un client habituel de ma mère. Il me vit et me regarda avec appétit. Je le trouvais dégueulasse.
— Ta fille devient déjà une femme ? Il posa sa main sur ma joue. Je me fis un plaisir de lui asséner une gifle.
— La prochaine fois que vous touchez ainsi, je crierai au voleur. Il n’en revenait pas de cette gifle.
— Tu m’as giflé, petite insolente ? Il était prêt à lever la main à nouveau sur moi, sous le regard de ma génitrice qui ne dit mot. Il haussa le ton.
La porte d’Annie s’ouvrit…
— N’essayez même pas de la frapper, sinon vous m’aurez en face. Sale porc ! Vous n’avez pas honte de vous en prendre à une enfant ?
— Éh toi la bordelle, on ne t’a pas sonnée, dit ma mère à Annie.
— Vous devez avoir honte de vous, Mme Tchana.
Quelle éducation voulez-vous inculquer à votre fille lorsque vous ramenez des hommes dans votre chambre qui vous couchent sur votre lit ?
Avez-vous idée du traumatisme que vous infligez à cette petite ?
ACHETEZ LE LIVRE: Amoureuse de mon patron
— Haha ! Regardez celle qui veut me conseiller. Haha ! Ferme-la et mêle-toi de tes affaires. Aya est ma fille. Je fais ce que je veux. Je paie mon loyer, je n’ai pas de conseiller à recevoir de toi.
— C’est vous la prostituée. Honte à vous !
Ma mère se jeta sur Annie et toutes deux se mirent à se battre. Le client profita de la situation et s’enfuit. Je me mis à appeler les autres voisins.
Sahid et Hakim venaient de franchir le portillon de la cité et s’empressèrent de les séparer.
Je regardais le visage d’Annie, et j’avais mal pour elle.
Ma mère s’était jetée sur elle comme une lionne, elle n’avait pas épargné son visage. Il était tout ensanglanté.
— Maman, regarde ce que tu as fait ! Tu es méchante, dis-je en pleurs.
— Ferme-la. Elle l’a bien cherché. Et toi, lâche-moi, dit-elle à Sahid qui la tenait. Hakim retenait la pauvre Annie.
— Je vous assure que je ne laisserai pas passer ça, je vais porter plainte pour coups et blessures. Criminelle ! dit Annie.
— Fais ce que tu veux, j’en ai rien à foutre. Il fallait rester à ta place. Malgré la nuit, la bagarre avait attiré nos voisins proches.
Sahid et Hakim conduisirent Annie au centre de santé du quartier pour des soins. Maman s’en fichait pas mal de son état.
Elle se mit à crier et demanda aux autres de libérer la devanture de sa maison. Ils se dispersèrent et rentrèrent…
— Maman, pourquoi ? Pourquoi ?
— Ferme-la. Tout ça, c’est de ta faute. Tu ne m’apportes que des ennuis. Je te hais. J’avais toujours mon plateau en main, je pleurais de toutes mes forces.
— Tu comptes rester dehors ? Entre là, je vais fermer ma porte. Enfant bâtarde ! Enfant bâtarde ! C’était blessant, mais ces mots avaient tout leur sens.
Je n’étais qu’une bâtarde, une enfant sans père, sans repère…
La scène n’empêcha pas ma mère de me demander la recette de la journée.
Je détachai une partie de mon pagne qui me servait de coussin sur lequel je posais mon plateau, enleva l’argent et lui donnai.
— Il manque deux mille francs CFA. Ils sont où ? me demanda-t-elle en haussant le ton.
— Un client m’a fait la recette de deux mille francs CFA et m’a remis un billet de dix mille francs CFA, soit huit mille francs CFA comme pourboire.
— Haha ! Donne-les-moi. Je remis cet argent à ma mère.
— Maman, s’il te plaît, je voudrais acheter mon livre de mathématiques avec cet argent. Mon professeur me mettra dehors si je ne l’ai pas la semaine prochaine. Elle me donna une gifle.
— Regarde-là, une menteuse promax. Tu couches déjà avec les hommes, Tchana ? De toute façon, ça ne devait pas tarder.
— Maman, non, je n’ai jamais permis à un garçon de s’approcher de moi. Je n’ai rien fait.
— Et pour rien, un homme te laisserait huit mille francs CFA comme pourboire ? Tu as travaillé quoi pour les mériter ? Elle me gifla à nouveau, je tenais ma joue en feu.
— Sale bordelle. Tu veux déjà me ramener une grossesse indesirée ici ? Tu ne me donneras pas un AVC. Mets-toi à genoux.
Je m’exécutai tout en priant la Vierge de me préserver d’un énième passage à tabac. Mais c’était peine perdue :
elle sortit de la commode son fouet. Un courant blanc et dur, avec lequel on connecte la gazinière au gaz. Je ne parle même pas de la douleur que ce fouet me procurait.
— Maman, s’il te plaît, ne me frappe pas. Je te dis la vérité.
Je n’ai rien fait de mal pour avoir cet argent. On me l’a donné comme pourboire.
— Tais-toi. Couche-toi à plat ventre. Je vais t’enlever tes fesses, tu ne les donneras plus jamais à un homme.
Mes supplications et mes pleurs ne changèrent rien à sa décision. Elle m’ôta ma longue robe usée ; je n’avais plus que mon slip sur moi. J’avais compté :
au total, je reçus dix coups aux fesses, qui étaient en feu. J’avais l’impression qu’on me les avait embrasées…
J’avais tellement pleuré que je n’avais plus de voix pour exprimer mon ressenti. Mon cœur était meurtri. Ma mère n’avait donc pas de cœur ? Était-elle faite de pierre ?
Comme après une bastonnade, je dormis sans rien manger ce soir-là.
Le lendemain, elle ne me donna pas non plus d’argent pour le goûter. Mon plateau de fruits m’attendait à mon retour, et je devais tout vendre avant de rentrer à nouveau le soir.
C’était ma vie, celle de Tchana-Robert.
- Lien vers le chapitre de la chronique amoureuse de mon patron